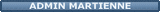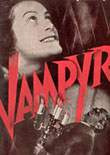 Vampyr ou l'étrange aventure de Davis Gray Carl Theodor Dreyer (1932)
Vampyr ou l'étrange aventure de Davis Gray Carl Theodor Dreyer (1932)(France-Allemagne - N&B - 1h12) Julian West, Henriette Gérard, Jan Hieronimko...
L'histoire
David Gray rentre à son auberge où un vieil homme lui confie un paquet à n'ouvrir qu'en cas de décès. La vie déjà somnambulique de Gray bascule alors. Il arrive dans un château étrange, noyé dans la brume, où la fille du châtelain, Léone, semble possédée. Le livre contenu dans le paquet révèle qu'en fait elle est vampirisée par une certaine Marguerite Chopin avec la complicité du médecin qui la soigne.
La suite offre un parallèle avec Carmilla, la nouvelle de Sheridan Le Fanu paru en 1872 dont le film s'inspire, mais sans pour autant oser mettre en scène les relations équivoques et saphiques qui s'illustraient dans l’œuvre originale. Les mœurs de l'époque ne s'y prêtant pas. Un autre texte (ou recueil de textes ?) semblent être aussi à l'origine du film : In the glass darkly, toujours de Sheridan Le Fanu.
La bande son est également à évoquer tant elle est particulière. En effet, elle est un mixte de film sonore et de film muet. Les dialogues, s'il en est, sont extrêmement épurés, ramenés le plus souvent à quelques mots éparses ne recevant le plus souvent aucune répartie. Et Dreyer utilise encore l'ardoise, principalement pour retranscrire des pages du livre que les protagonistes vont lire.